"Sortir les élèves de certains stéréotypes : « Les maths, ça sert à compter, à calculer, à ne pas se faire voler au magasin… » « Le français, ça sert à être poli, à bien parler, à ne pas faire de fautes... »
Comment faire évoluer ces représentations ?
Pour les mathématiques :
Montrer que les mathématiques ont une HISTOIRE. Ce n’est pas une matière figée, hors du temps.
D’où est venue la nécessité de « faire » des mathématiques ?« le contenu des mathématiques ». Nombre de mathématiciens considèrent comme « découverte » ce qui est en réalité une « création ». L’analyse historique montre que nos mathématiques sont construites sur les nombres entiers. Un berger a du vouloir quelque part compter le nombre de ses moutons... Nécessité de la création d’un langage spécifique pour décrire les nouveaux concepts créés.
La place croissante prise par les mathématiques depuis le XIXe siècle.
Au début du XXe, l’évolution économique engendrera l’évolution de l’enseignement des maths. Un des objectifs premiers de l’enseignement des maths fut d’aider à la maîtrise de la langue et de la pensée..
Le système condamne l’élève à trouver. Il faudrait considérer que CHERCHER est en soi une activité formatrice.
Contre le DRESSAGE de l’élève à une application docile, systématique et rassurante...
Les contenus mathématiques doivent apprendre à résister aux déductions tentantes. Acquérir l’esprit critique est indispensable dans notre société surinformée. C’est le rôle de l’école.
Pour le français :
Le français a lui aussi une HISTOIRE. Ce n’est pas non plus une matière figée. La langue évolue. De plus il est important de montrer aux élèves que le processus de la création littéraire ne relève pas de la « révélation » : c’est un travail laborieux de construction, de reprises, d’ajustements, d’emprunts (d’où la nécessité de les familiariser avec les traitements de texte).
Le dressage et les activités répétitives peuvent aussi être repérés dans l’enseignement du français : beaucoup d’exercices privés de sens, l’outil est souvent valorisé par rapport à l’objectif, encore trop de relevés mécaniques d’indices sans hypothèses de lectures. Il est nécessaire de considérer le travail en français comme une occasion fournie aux élèves pour développer à la fois leur créativité (et le plaisir qui y est lié) et l’esprit critique.
Un stéréotype sur lequel il faut travailler : le beau parleur. Beaucoup de collègues d’autres disciplines ont du français l’image d’une matière où il suffit de faire de belles phrases, où il faut séduire, voire tromper son auditoire. Il est nécessaire de revaloriser la rigueur et l’analyse et de restaurer l’image de la rhétorique comme une discipline au service de la morale et de la démocratie (le débat).
Le statut particulier du français, à la fois objet d’étude et langue-outil.Les maths utilisent un langage précis et codifié. Mais pour en parler, on utilise le français comme langue-outil (le métalangage).Et c’est pour cela que le prof de maths est aussi un prof de langue. Apprendre aux élèves à rendre compte de ce qu’ils font (par écrit ou à l’oral) permet non seulement de vérifier en profondeur leur compréhension des mathématiques mais encore de développer leurs compétences dans la langue naturelle.
Lire, comprendre, écrire et traduire en maths.
Lire et comprendre :
Recensement des origines des problèmes de lecture et de compréhension d’un énoncé mathématique. Coopération avec le professeur de français.
Observations et synthèse des difficultés des élèves sur les cahiers d’évaluation. Diagnostic après observation d’un corpus de textes. Analyse conjointe des profs math et de français.
Quel français utilise-t-on en maths ? Repérage de quelques traits caractéristiques : les différentes façons de donner un ordre, l’utilisation du « on », les énumérations, les listes, le désir de gommer les traces de la situation d’énonciation…) Les exigences langagières des maths sont assez éloignées du langage courant utilisé dans les autres disciplines. Proposition : une analyse discursive des énoncés mathématiques.
Profs de maths, profs de français : même combat...
Difficultés qui peuvent être travaillées en français et en maths :lexique ; mots de liaison ; mots quantificateurs ; polysémie ;symboles ; polysémie des symboles ; syntaxe ; ponctuation ;repérage de la consigne ; repérage de l’information ;multiplicité des supports d’information ; adaptation d’une stratégie de lecture ; linéarité ou non d’une lecture...
Nécessité de travailler avec les élèves :
Les stratégies de lecture. Les expliciter lors d’entretiens avec les élèves.
La distinction entre information et consigne. Il faut aussi différencier les types d’informations, les différents types d’injonctions. Exercices de « segmentation ». Informations et injonctions bien séparées...imbriquées...
La définition des mots « flous » communs aux deux disciplines (hauteur, par ex.), la valeur des articles (définis, indéfinis), les mots de comparaison (tout ce qui porte en général sur la mise en relation).
Ne pas dissocier les difficultés de compréhension des élèves de Polynésie en lectures de consignes (maths ou français) de leurs difficultés générales par rapport à la langue (représentation pauvre de la communication ; absence de communication en famille...).
Traduire et écrire pour comprendre.
Traduire : passer de la langue à un langage, d’un langage à un autre langage. Exemple : d’un énoncé en langue naturelle à un énoncé en langage mathématique, d’un texte à un schéma, d’un texte de roman (ex sur un roman de Zola) à un arbre généalogique etc.
Le même travail peut être exécuté à partir de deux énoncés différents.
Reformuler des énoncés .
L’importance de la narration de recherche pour stabiliser les acquis. Voir CP n° 316.Voir l’utilisation de la narration de recherche dans le cahier de bord des TPE (première et terminale).
Des exercices interdisciplinaires en maths et en français, exercices interactifs à proposer aux élèves.
Les apports réciproques des maths et du français.
Exemple de texte délibératif écrit à partir de Mateo Falcone :
FortunatoQue vais-je faire ? Trahir ou respecter la tradition corse ?Si je trahis, ma famille sera la risée de Porto Vecchio et de la Corse.Mais si je la respecte, en aidant Gianetto, mes parents seront très fiers de moi.Mais une montre qui brille comme de l’or, je n’en ai jamais eue, et, en plus, elle vaut plus que la pièce de 5 F que m’a donnée le bandit pour le cacher.Si j’échange le bandit contre cette jolie montre, je pourrai montrer aux gens l’heure, et je dirai aux belles filles de regarder elles-mêmes, et, comme ça, j’aurai l’air d’un riche.Oui, mais si je le dénonce, mon père sera très furieux contre moi parce que le bandit est gravement blessé à la jambe.J’ai trouvé, je vais le dénoncer, et lorsque mon père verra la montre, je dirai qu’elle m’a été offerte.Mais si les habitants disent à mon père que son fils est un traître, il va me tuer.Oui, mais quelle décision prendre ?J’aimerais une montre pareille à celle-la.Excuse-moi, Gianetto, je la veux, cette montre.Adjudant Gamba, le bandit est là.Moeata
Démonstration et argumentation : une gêne possible dans l’apprentissage.Démonter, argumenter et persuader :
Démontrer
Argumenter
Persuader
- logique formelle excluant les ambiguïtés (raisonnements analytiques)
- démarche dialogique qui met en œuvre des jugements de valeur ; non dépourvue d’ambiguïtés (raisonnements dialectiques)
- art de la suggestion ou de la manipulation
- démarche rationnelle s’adressant à l’entendement
- vise à la conviction rationnelle en faisant appel à l’entendement
- vise la persuasion par tous les moyens, même irrationnels
- raisonnements impersonnels et contraignants
- raisonnements non impersonnels et non contraignants
- rôle essentiel de l’image de celui qui cherche à persuader
- domaine de la vérité (alètheia)
- domaine de l’opinion (doxa)
- une seule preuve peut être décisive
- argumentation plus ou moins abondante
- auditoire universel
- auditoires particuliers, mais vise souvent un auditoire universel
- auditoires particuliers (« cibles »)
- auditoire impliqué dans la recherche du préférable
- auditoire passif
Les élèves confondent souvent démonter et argumenter. Les deux activités sont distinctes. On ne convainc pas comme on démontre.« Qu'est-ce qui distingue l'argumentation d'une démonstration formellement correcte ? »« Tout d'abord le fait que, dans une démonstration, les signes utilisés sont censés dépourvus de toute ambiguïté, contrairement à l'argumentation qui se déroule dans une langue naturelle, dont l'ambiguïté n'est pas exclue d'avance. Ensuite parce que la démonstration correcte est une démonstration conforme à des règles, qui sont explicitées dans les systèmes formalisés. Mais aussi, et c'est sur ce point que nous insisterons, parce que le statut des axiomes, des principes dont on part, est différent dans la démonstration et dans l'argumentation.Dans une démonstration mathématique, les axiomes ne sont pas en discussion ; qu'on les considère comme évidents, comme vrais, ou comme de simples hypothèses, on ne se préoccupe guère de savoir s'ils sont ou non acceptés par l'auditoire. D'ailleurs, celui qui voudrait justifier le choix des axiomes, devrait, comme l'a déjà remarqué Aristote, dans ses Topiques, recourir à l'argumentation.Comme le but d'une argumentation n'est pas de déduire les conséquences de certaines prémisses, mais de provoquer ou d'accroître l'adhésion d'un auditoire aux thèses qu'on présente à son assentiment, elle ne se déroule jamais dans le vide. Elle présuppose, en effet, un contact des esprits entre l'orateur et son auditoire : il faut qu'un discours soit écouté, qu'un livre soit lu, car, sans cela, leur action serait nulle. » pp 23-24Ch. Perelman, L’empire rhétorique Rhétorique et argumentation, Vrin
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
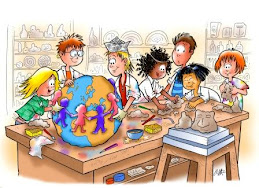
Nessun commento:
Posta un commento