L'esclavage caractérise le fait de priver un être humain de ses droits (droit de choisir son travail et son lieu de résidence, droit de fonder une famille et d'élever ses enfants, droit de s'instruire et de nouer des relations avec les personnes de son choix, droit de se déplacer à sa guise) et de le réduire au statut d'un bien mobilier que l'on peut acheter et vendre (les personnes emprisonnées au nom de la loi pour s'être rendues coupables d'un crime ou d'un délit n'entrent pas dans cette définition).
L'esclavage semble avoir été ignoré des sociétés primitives nomades de chasseurs et de cueilleurs. Les sociétés de cette sorte qui subsistent en Amazonie ou en Papouasie l'ignorent également.
L'esclavage est apparu avec la sédentarisation des humains dans les villes et le développement de l'agriculture et de l'élevage.
Les guerres pour l'appropriation des terres et des troupeaux procurent des captifs que l'on affecte aux travaux des champs, à la garde des troupeaux ainsi qu'aux tâches domestiques, à la meunerie ou encore au pompage de l'eau. Que faire d'autre de ces captifs, en effet, lorsqu'on ne peut pas les échanger contre des captifs de l'autre camp ? Les tuer ? Les nourrir en prison ?...
C'est ainsi qu'au cours du dernier millénaire avant JC, la pratique de l'esclavage devient commune à toute l'humanité, hormis quelques tribus reculées de l'Âge de pierre. On peut noter toutefois de grandes différences dans son application.
L'esclavage à l'aube de notre ère
La Crète ou encore l'Étrurie (la région de Florence, en Italie) limitent, semble-t-il, l'esclavage aux captifs de guerre et aux travailleurs des mines. Les témoignages plus ou moins étoffés que nous possédons sur ces sociétés indiquent que leur paysannerie est essentiellement composée d'hommes libres. Il est intéressant d'observer que les femmes de ces sociétés-là bénéficient aussi d'un statut relativement honorable pour l'époque... comme si l'esclavage et l'oppression de la femme allaient de pair !
L'Égypte pharaonique, du moins dans les premiers temps de sa longue Histoire, relève d'une situation comparable. Mais pendant le Nouvel Empire (de 1543 à 1069 avant JC), notamment sous le règne de Ramsès II, la multiplication des campagnes de «pacification» entraîne l'afflux d'esclaves étrangers que le pharaon alloue aux temples, affecte au service de sa maison ou... intègre à son armée. Parmi ces esclaves étrangers, on note la présence de Noirs du pays de Koush, au sud d'Assouan (Nubie, Darfour). Si l'on en croit la Bible, on note aussi la présence d'Hébreux. Le Nouvel Empire va succomber du fait de la prise du pouvoir par d'anciens esclaves libyens devenus officiers (*).
Chez les Hébreux comme chez les autres peuples du Moyen-Orient, l'esclavage va de soi. Le Lévitique, le livre de la Bible qui regroupe les principales lois hébraïques, autorise sans réserve l'esclavage des non-juifs et limite à sept ans la durée pendant laquelle un juif peut être tenu en esclavage.
La situation est très différente dans le monde grec et son appendice, la société romaine. Bien qu'ils aient inventé la démocratie, les Grecs de l'époque classique ne voient aucun inconvénient à la pratique massive de l'esclavage, dans des conditions généralement odieuses. C'est sur les esclaves que repose l'économie, qu'il s'agisse de l'artisanant urbain, des travaux domestiques ou encore des exploitations minières du Laurion. Parmi ces esclaves figurent des Africains, appelés «Éthiopiens» (en grec, «Faces brûlées»). Parallèlement, notons-le, les Grecs ne montrent guère de considération pour les femmes, qu'ils tiennent à l'écart dans le gynécée (le grand Périclès fait figure d'excentrique par l'amour qu'il porte à sa chère Aspasie, qui est, il est vrai, une étrangère).
Si le philosophe Platon considère que tous les êtres humains - hommes et femmes - sont d'une même essence, il n'en va pas de même de son élève Aristote qui justifie l'esclavage ainsi que les inégalités qui s'attachent au statut comme au sexe : «Il est évident qu'il y a par nature des hommes qui sont libres et d'autres qui sont esclaves, et que pour ceux-ci, la condition servile est à la fois avantageuse et juste» (La Politique).
À Rome, où les esclaves représentent jusqu'à un tiers de la population urbaine, leurs conditions de vie sont généralement impitoyables. Le souvenir de Spartacus, esclave révolté au premier siècle avant notre ère, est dans toutes les mémoires. «À l'apogée de l'Empire, l'Italie aurait abrité deux à trois millions d'esclaves, soit 35 à 40% de sa population totale», rappelle l'historien Olivier Pétré-Grenouilleau. «À la différence de la Grèce antique [...], la majeure partie était utilisée dans l'agriculture» (*).
Christianisme et esclavage
Le développement de la philanthropie païenne et du christianisme aux premiers siècles de notre ère contribue à l'améliorer mais ne remet pas en question le principe même de l'esclavage.
L'Église se contente de prescrire aux maîtres de ne pas maltraiter inutilement les leurs et à ceux-ci d'obéir dans l'attente d'une récompense au ciel. Elle-même possède ses propres esclaves. Comme la plupart de ses autres biens, ils lui viennent de legs de personnes pieuses.
Saint Paul ouvre une brèche dans le consensus en proclamant l'égalité de tous les êtres humains en Jésus-Christ : Il n'y a ni hommes ni femmes, ni Juifs ni Grecs, ni hommes libres ni esclaves, vous êtes tous un en Jésus-Christ » (Épître aux Galates). Mais lui-même ne va pas jusqu'à s'offusquer de l'esclavage et encore moins réclamer son abolition. Notons que les quatre Évangiles canoniques ne font aucune allusion à l'esclavage.
Alban Dignat
sabato 27 ottobre 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
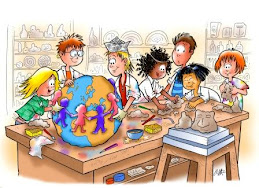
Nessun commento:
Posta un commento